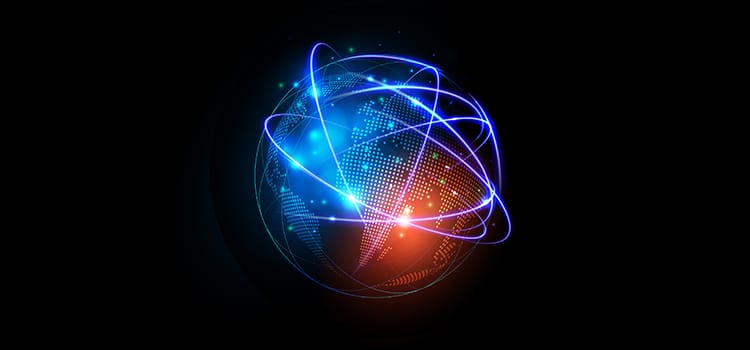Cet article a été publié pour la première fois sur l’espace abonnés Navis (ELF), et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de ses auteurs.
Le Conseil d’État se livre à une analyse fine des conditions dans lesquelles les vérificateurs sont susceptibles d’apporter les éléments constitutifs de la présomption de transfert indirect de bénéfices prévus par les dispositions
de l’article 57 du CGI.
Dans son arrêt Menarini du 7 mai 2025 (CE 7-5-2025 n° 491058, Sté Menarini, concl. B. Lignereux : FR 27125 inf. 1), le Conseil d’État nous apporte des éléments précieux en se livrant à une analyse fine des conditions dans lesquelles les vérificateurs sont susceptibles d’apporter les éléments constitutifs de la présomption de transfert indirect de bénéfices, premier temps du raisonnement prévu par les dispositions de l’article 57 du CGI. Notre analyse se concentrera ici uniquement sur cet aspect des rectifications en matière de prix de transfert. Reste que cette décision favorable au groupe devrait probablement annoncer un résultat négatif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en renvoi, selon les conclusions de Bastien Lignereux, rapporteur public dans cette affaire.
La société française Menarini Diagnostics France est une filiale du groupe pharmaceutique italien Menarini. Elle exerce une activité de distribution en France sur deux segments :
- l’achat et la vente d’appareils dans le domaine de l’autodiagnostic (branche dite« Check-up») ;
- l’achat et la vente de matériels et de leur installation pour des laboratoires d’analyse médicale (branche
« Laboratoires»).
La société française achète les appareils d’ autodiagnostic à un membre du groupe ; elle acquiert le matériel nécessaire pour les laboratoires d’analyse médicale soit directement auprès d’un fournisseur tiers, soit par l’intermédiaire d’une filiale italienne du groupe. Elle bénéficie également de l’aide apportée par son actionnaire principal, qui lui facture des prestations d’orientations stratégiques et de développement de nouveaux produits, ainsi que le soutien de la marque à l’international.
Ayant constaté que la société française était déficitaire sur plusieurs exercices, l’administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité au titre des exercices 2011 à 2013. Elle a estimé que la société avait indirectement transféré des bénéfices aux sociétés italiennes du groupe. Elle a, d’une part, considéré que le prix d’achat de produits acquis auprès de la filiale italienne était trop élevé, en comparaison avec celui payé directement au fournisseur tiers. Elle a estimé, d’autre part, que la société française avait supporté des dépenses importantes « au profit du groupe», sans contrepartie équivalente.
La société a contesté ces rectifications en matière de prix de transfert. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d’appel de Paris (CM Paris 22-11-2023 n° 21PA06233), qui a notamment confirmé le transfert indirect de bénéfices au profit de deux sociétés italiennes du groupe en relevant que la société française n’exerçait qu’une simple activité de distribution, si bien qu’elle ne pouvait supporter des pertes, lesquelles auraient dû être supportées par l’entrepreneur principal.
Les 9e et 10e chambres réunies du Conseil d’État ont articulé leur décision autour de deux points importants : le traitement des déficits en tant qu’indice de transfert de bénéfice et la possibilité de recourir à un comparable unique dans le cadre de l’application de la méthode du prix comparable sur le marché libre avec un comparable interne (CUP interne). Le Conseil d’État n’a en revanche pas fait état de l’examen critique conduit par le rapporteur public quant à l’utilisation par l’administration d’une méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) «globale».
Déficits récurrents : l’indice ne fait pas la preuve
Le Conseil d’État fait disparaître tout doute, comme le lui recommande son rapporteur public, sur le fait que la situation déficitaire d’une entreprise et des charges élevées, même sur plusieurs exercices, ne sauraient suffire à fonder une présomption de transfert de bénéfices au sens des dispositions de l’article 57 du CGI.
Les vérificateurs avaient relevé que la société française dégageait des pertes récurrentes sur plusieurs exercices alors qu’elle ne se trouvait plus en phase de développement ; pour ces derniers, la société exerçait une activité de distribution supposée structurellement bénéficiaire. La cour administrative d’appel de Paris avait validé cette analyse en soulignant le caractère « récurrent» des pertes, « en dépit de la rentabilité propre de ses activités», et en écartant toute justification tenant à une phase de démarrage.
Les vérificateurs soulignaient également que les taux de marge nette de l’ensemble des produits distribués par la société étaient négatifs. Ils associaient cette situation au poste de dépenses « Autres achats et charges externes », qu’ils estimaient trop élevé en proportion du chiffre d’affaires (entre 28 % et 43 % sur la période de 2007 à 2013). Aux termes des constatations des vérificateurs, ces mêmes dépenses représentaient en moyenne 13 % seulement du chiffre d’affaires des sociétés indépendantes comparables, ce que la cour administrative d’appel de Paris avait validé.
Le Conseil d’État marque son désaccord en se prononçant explicitement sur ce second point (l’observation d’un niveau de charges élevé) : faute de préciser quelles dépenses comptabilisées dans le poste « Autres achats et charges externes » auraient été exposées dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe, les circonstances retenues ne suffisent pas à établir une présomption de transfert de bénéfices. Autrement dit, un poste de charges plus élevé que celui des comparables ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un avantage ou une libéralité consenti à une entreprise liée.
Le Conseil d’État n’évoque pas explicitement les pertes récurrentes. Il nous semble néanmoins confirmer implicitement le principe que rappelle son rapporteur avec limpidité : le seul constat de pertes récurrentes ne saurait suffire à établir l’existence d’un transfert indirect de bénéfices.
Les dispositions de l’article 57 du CGI supposent en effet, conformément à la jurisprudence constante, soit la démonstration d’un avantage économique concret, accordé à une entité associée établie à l’étranger, soit l’existence d’un écart significatif et injustifié entre le prix pratiqué et la valeur de marché d’un bien ou d’un service. La charge de la preuve pèse ainsi sur l’administration, qui doit établir, sur une base strictement transactionnelle, l’existence d’un flux international sans contrepartie suffisante.
Bastien Lignereux nous rappelle dans ses conclusions que cette position est pleinement conforme aux principes OCDE en matière de prix de transfert, lesquels reconnaissent que des déficits peuvent résulter de motifs économiques légitimes (Principes OCDE § 1.149).
En l’espèce, l’administration s’est limitée à une comparaison agrégée des charges de la société avec celles d’entreprises du même secteur. Or, comme le rappelle implicitement le Conseil d’État, un benchmark global ne saurait tenir lieu de preuve, en l’absence de rattachement à des transactions identifiées. La constatation de charges élevées ne peut être suffisante, encore faut-il démontrer quelles dépenses précises ont été engagées dans l’intérêt exclusif du groupe, sans bénéfice direct ou indirect pour la société française. C’est à cette condition que peut naître une présomption d’avantage ou de transfert.
Le Conseil d’État confirme ainsi sa jurisprudence, déjà illustrée par les décisions Cap Gemini (CE 7-11-2005 n° 266436 et 266438 : RJF 1/06 n° 17, concl. E. Glaser) et Amycel (CE 16-3-2016 n° 372372 : RJF 6/16 n° 514, concl. F. Aladjidi), selon laquelle les pertes peuvent constituer un indice, mais non une preuve en soi. Gageons que ce rappel, sur les pertes et un compte de charges élevé, mettra un terme au réflexe récurrent des services de vérification de faire des déficits le point de départ et d’arrivée de leur raisonnement en matière de prix de transfert.
Un comparable interne unique peut être suffisant
La méthode du prix comparable sur le marché libre est, selon les principes OCDE, la plus directe des méthodes de détermination des prix de transfert. Elle consiste à comparer le prix pratiqué à l’occasion d’une transaction avec une entreprise liée avec celui observé lors d’une transaction entre entreprises indépendantes, pour des biens ou services similaires, dans des circonstances comparables. Cette comparaison peut être « interne », lorsqu’une entreprise réalise des transactions comparables avec des tiers, ou « externe », lorsqu’il s’agit de comparer la transaction intragroupe avec celles que réalisent des tiers.
En l’espèce, les vérificateurs ont pu identifier une transaction réalisée par la société avec un tiers comparable à celles que cette dernière réalise avec une société sœur : ils ont comparé le prix des produits achetés par la société française à sa filiale avec celui d’une autre gamme de produits achetés à un fournisseur tiers.
Le Conseil d’État valide cette approche. Il introduit ainsi un élément nouveau, à confirmer sans doute en dehors de cette affaire, puisqu’il admet le recours à un comparable interne unique considéré en l’espèce comme suffisamment fiable. Cette position, qui ne semble pas détaillée avec vigueur par Bastien Lignereux, pourra sembler étonnante aux praticiens puisqu’elle s’oppose à la théorie évidente – au demeurant habituellement partagée par le juge comme par l’administration fiscale – selon laquelle un panel de comparables doit être composé de suffisamment de sociétés pour être considéré comme représentatif du marché libre. Une portée générale ne saurait lui être accordée puisqu’elle ne trouverait pas à s’appliquer s’il existe plusieurs comparables internes ou externes (au cas présent, la circonstance particulière était qu’un seul comparable interne existait, dont les caractéristiques ont été considérées comme suffisantes pour le traiter comme tel).
Au demeurant, la fiabilité de ce comparable pourrait donner lieu à débat. le Conseil d’État semble en effet se satisfaire du simple fait que « les deux gammes de produits s’adressaient à la même clientèle, dans le même secteur d’activité» et que « le comparable interne retenu était représentatif d’une part significative du chiffre d’affaires». L’OCDE impose pourtant, dans ses principes en matière de prix de transfert, la démonstration de cinq facteurs de comparabilité. Considérer que deux gammes de produits sont comparables parce qu’elles s’adressent à la même clientèle dans le même secteur d’activité apparaît comme une simplification extrême lourde de conséquences en matière de dialectique de la preuve.
En ne procédant pas à cette appréciation complète des cinq critères de comparabilité (termes contractuels. analyse fonctionnelle incluant l’analyse des fonctions, des actifs et des risques, caractéristiques des biens ou services, circonstances économiques et stratégies commerciales), il pourrait être prêté l’intention au Conseil d’État de douter qu’il revient à l’administration de démontrer la fiabilité des comparables qu’elle entend retenir. Il reviendrait ainsi au contribuable de prouver en quoi les comparables choisis par cette dernière ne sauraient être retenus. La cour administrative d’appel de Paris avait ainsi explicitement indiqué que la société ne mentionnait pas les ajustements qui devraient être apportés selon celle-ci.
Si tel était le cas. serait alors reconnue à l’administration une « présomption de comparabilité», dès lors qu’un comparable interne serait identifié, quand bien même l’ensemble des critères de comparabilité ne seraient pas réunis et analysés. Il reviendrait à l’entreprise de démontrer que les différences substantielles (qu’elles tiennent aux volumes, aux dates, aux conditions contractuelles, à l’allocation des fonctions et des risques ou encore aux stratégies commerciales) sont de nature à invalider la comparaison ou à justifier des ajustements.
Cette décision du Conseil d’État deviendrait alors une anomalie, en inversant le raisonnement probatoire selon lequel l’administration se doit de démontrer l’existence d’un avantage, accordé par une entreprise établie en France à une entreprise associée établie à l’étranger ou l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu, pour démontrer l’existence d’une libéralité consentie par l’entreprise établie en France.
La MTMN globalisée : une dérive méthodologique
La méthode du prix de revente (Resale Price Method ou RPM) et la MTMN sont deux méthodes de détermination des prix de transfert reconnues par les principes OCDE. Elles obéissent à des logiques différentes.
La méthode RPM vise à reconstituer le prix d’acquisition d’un bien lors d’une transaction intragroupe à partir du prix de revente à un tiers indépendant, en le diminuant d’une marge brute observée sur le marché. Elle permet d’estimer le prix de pleine concurrence d’un bien ou d’un service entre entités liées, en s’appuyant sur les marges brutes constatées à l’occasion de transactions comparables entre indépendants.
La méthode MTMN repose sur une logique différente. Elle consiste à comparer un indicateur de profitabilité réalisé par l’entité testée (généralement la partie la moins complexe) avec ce même indicateur relevé dans des entreprises indépendantes exerçant des fonctions similaires, dans des conditions économiques comparables.
La société utilisait la méthode RPM, adaptée aux activités de distribution et d’achat-revente. L’administration fiscale lui a préféré la MTMN, au motif que la RPM ne pouvait pas être utilisée lorsque les marges sont négatives. Si cette approche est commune en matière de prix de transfert, la façon dont s’en est servie l’administration fiscale est plus discutable.
La MTMN peut être utilisée à condition que l’analyse porte sur un indicateur de profit pertinent, appliqué à une transaction ou à un périmètre homogène. Les principes OCDE prévoient que la méthode MTMN consiste à déterminer le bénéfice net que réalise un contribuable au titre d’une transaction donnée conclue avec une entreprise liée (Principes OCDE § 2.62, 2.63, 2.64, 2.82, 2.83, 2.84 et 2.96) ou au titre de transactions combinées, conclues avec une telle entreprise (Principes OCDE § 2.64 en lien avec les § 3.9 s.). par référence au bénéfice net réalisé au titre de transactions comparables sur le marché libre.
En l’espèce, l’administration fiscale a établi un taux de marge nette moyen, à partir d’un échantillon de comparables, sans segmenter les transactions par activité ni identifier précisément les opérations concernées. Elle a ensuite appliqué ce taux, de façon globalisée, à l’intégralité du chiffre d’affaires de la société. quelle qu’en soit la nature, sans ajustement fonctionnel ni justification transactionnelle (et non aux recettes tirées d’une transaction donnée ou d’un ensemble de transactions conclues avec une société du groupe).
Cette utilisation de la MTMN, à des fins de reconstitution d’un résultat global, s’éloigne des standards OCDE qui insistent sur le caractère transactionnel des méthodes de prix de transfert. Cette méthode, même si elle est plus souple que la CUP ou la RPM, doit être appliquée à des transactions comparables, et non à un ensemble hétérogène d’opérations aux caractéristiques économiques différentes.
Bastien Lignereux détaille ainsi qu’« une telle méthode globale, dès lors qu’elle ne fait pas apparaître par quel biais des bénéfices auraient été transférés à une entreprise étrangère liée, met à l’épreuve la lettre de [l’article 57 du CGI], qui ne permet à l’administration de bénéficier de la présomption qu’il institue que si elle démontre qu’un avantage a été accordé à l’entreprise étrangère par manipulation du prix d’une transaction ou par tout autre moyen ».
Il rappelle de la sorte que l’administration ne saurait faire I’ économie de la démonstration juridique exigée par la jurisprudence constante: l’identification d’une libéralité ou d’un avantage économique transféré, tel que prévu par les dispositions de l’article 57 du CGI, ce que ne permet pas l’agrégation globale des résultats, sans corrélation précise avec une transaction déterminée.
Si le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur ce point, gageons que ce rappel opportun clarifiera le recours à cette méthode, en mettant un terme à son usage dévoyé qui tend parfois à se généraliser, en dépit de sa faiblesse conceptuelle.